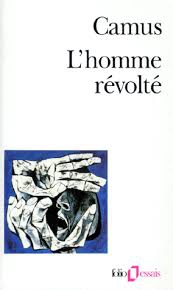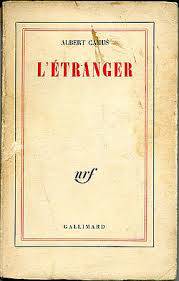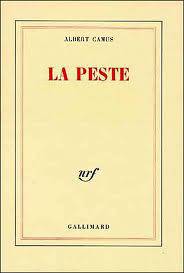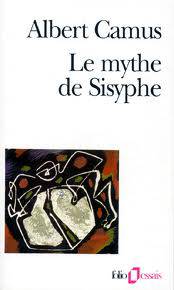Camus.
"L"homme révolté" - Albert Camus -.
« L’homme révolté »
A première vue, cet opus camuséen fait davantage étalage d’une culture littéraire, il est vrai manifeste, qu’il ne propose de théorie décisive sur la révolte, d’autant que si l’on contextualise l’intentionnalité psychique du révolté, on converge forcément vers un réalisme ponctuel, intangible au principe d’intentionnalité, si bien que l’argumentaire référentiel à la littérature trahit une sorte de formalisme descriptif en réalité presque inutile à la contemporanéité notionnelle. La révolte sonne le glas d’une humanité chevillée à sa condition, soit, on peut soumettre l’aspect revendicatif d’une liberté totale à la destruction qu’opérât Sade en son temps et y voir comme Camus une preuve d’affirmation universelle, ou bien synthétiser « la volonté de puissance » nietzschéenne en une sorte de pari « méthodique » anticonformiste, et ce faisant tout autant nihiliste, ou plutôt ascétique, car la liberté promue par Nietzsche « le dire oui à la vie » est en définitive un renoncement, l’abandon de la servitude, c’est certain, au nom d’une volonté qui se réclame d’elle-même (en quelques sortes le doute hyperbolique de Descartes), et des jugements de valeurs. Mais une existence sans jalon, sans loi ….. Peut-elle se revendiquer comme telle ? Faut-il nier l’évidence pour être libre ? C’est un peu le constat que fait Nietzsche en abandonnant l’homme à ses valeurs primordiales. D'autant que Nietzsche est contraint de crier pour réveiller les hommes, or comme l'indique Heidegger "Ce n'est pas dans un cri que la pensée parvient à se faire entendre", la tempérance promue par Heidegger annihile tout instinct séditieux, revendique une voie saine que l'esprit de révolte semble méconnaître C’est indéniablement la spécificité thomiste de la pensée nietzschéenne qui l’amenât à estimer, encenser, le macrocosme de l’Art, et par là le feu d’Héraclite, la source de l’un-primordial, statuant arbitrairement d’une thématique philosophique où l’Art devient cette échappatoire obligatoire au scientisme (cf. « Aux origines de la Tragédie »).
La révolte est le témoignage d’une attitude hostile à son temps, à sa classe…, mais l’objection peut aussi revêtir le marqueur soudain, injustifié du moment, qu’est-ce donc que la révolte si aucun mouvement révolutionnaire n’est décelé, ni qu’aucun raccord idéologique n’implique la fédération d’une masse quelconque. André Breton, qui devait passer le plus clair de son temps à dormir, énonce sans intention le principe essentiel à l’œuvre dans la révolte qui n’est autre qu’une dynamique contradictoire à la subjectivité, un principe contestataire qui dans certains cas verse dans la mystification parodique : « Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire. C’est à sa conquête que je vais, certain de n’y pas parvenir mais trop insoucieux de ma mort pour ne pas supputer un peu les joies d’une telle possession ». C’est joli la rébellion par ces quelques atours freudiens, mais on voit ici que la révolte n’est autre qu’une forme de nihilisme fantaisiste, dont l’inclinaison démagogique nous fait scruter le réel avec davantage d’intérêt - sans remettre en question la théorie de Freud sur l’interprétation des rêves. Pour Breton la surréalité prône la liberté par la subversion, l’hostilité envers tout ce qui compose la condition matérielle et morale des hommes, pour une morale neuve capable de solutionner tous nos maux, une lutte désespérée pour ainsi dire. Une théorie anarchiste dont l’incursion dans le domaine de la pensée révèle une marque d’esprit apatride, éloignée d’une cohérence fondée à l’univers artistique. La totalité irrationnelle que prône la surréalité, « le hasard objectif », donne à la révolte ce ton négatif d’une direction sans issue, laissant Nietzsche s’accommoder sans modération de l’innocence d’un soleil au zénith.
Si pour Camus la révolte est le seul moyen de dépasser l’absurde, qu’elle s’approprie la déviance humaine, crime etc….de manière systématique - sans analyse psychologique préalable -, nous laisse entrevoir cette césure quasi polémique entre l’irrationnel et la dignité qu’implique un esprit doté de raison, et ainsi sur l’inanité d’un tel débat ; car doit-on comme, dans le mythe de Sisyphe, adhérer à l’extrémité d’une humanité radicalisée, poussée dans ses retranchements tourmentés et d’où les ponts vers ces états dominés par le règne de la raison sont à jamais rompus. C’est aussi la marque de tout récit elliptique, de chercher à tout prix une analogie quel qu’en soit le prix ; en quoi la filiation historique donnerait aux mouvements révolutionnaires, quel qu’il soit, cette inviolabilité notionnelle que cherche à caractériser Camus, lesquels sont à jamais captifs d’un contexte précis, d’une inclusion sociale distinctive où le peuple dans la mesure de sa volonté exprime, [mesure n’est pas innocent], ce qui en un lieux, doit être sa vérité, car finalement dans l’acception mesure nous est livrée la réalité du « contrat social », et l’acuité d’une notion qui se réclame d’une universalité inattaquable mais qui se heurte malgré cela à la réalité d’un contexte.
« La vie est cette puissance de configuration d’un vivant et de son milieu….si bien qu’on pourrait reprendre cette formule de Dilthey, que la vie se comprend et s’interprète elle-même… », c’est en ce sens qu’il faut saisir le caractère subjectif réciproque de l’intention, laquelle implique toujours, et par essence, un lien constitutif à un monde ambiant ; pour l’homme cette existence dans une totalité imparfaite se révèle telle une lutte en opposition à cette plénitude comme l’indique Patočka : « L’animal est entier, la vie animal est une vie dans l’unité, intégrée sans discontinuité dans tout le reste de la nature….. L’animal n’a aucune égoïté, puisque c’est la totalité qui agit en lui….Il n’a pas besoin d’un rapport explicite à la totalité-il est lui-même cette totalité. L’homme au contraire s’est mis à part. Le rapport humain à la totalité signifie chez l’homme qu’il y a une incomplétude essentielle, une révolte contre la totalité, une dissension avec elle. L’homme vie dans un rapport à la totalité parce qu’il ne vit pas en totalité et à partir d’elle. La vie humaine est à vrai dire une vie contre la totalité ». La force à l’œuvre dans la révolte est cernée, circonscrite et localisée au sein d’une continuité active où l’être de l’homme semble étranger à la constitution de ce qui est, un constat préoccupant. Il en est rien, car c’est par ce destin inachevé que la quête du sens prend son essor et vient parachever l’expérience universelle de la nature : « C'est vérifiable chez tous les animaux, non seulement par l'observation externe, mais aussi par l'observation interne, par la dissection. Un organe, dont la destination n'est pas d'être utilisé, une structure qui n'atteint pas son but est incompatible avec une étude téléologique de la nature. Car, si nous nous écartons de ce principe, nous n'avons plus une nature conforme à des fins, mais un jeu de la nature sans finalité, et le hasard désolant détrône le fil directeur de la raison ». Kant.
« Je me révolte, donc nous sommes.. », et la révolte métaphysique ajoutait alors le « nous sommes seuls.. » écrivait Camus, ce constat d’une servitude assurée doit échapper à son renoncement et retrouver la vigueur créatrice qui fait ces esprits de conquêtes, entraînant l’humanité vers un épanouissement commun à chacun.
"L'étranger' - Albert Camus -
- L'étranger -
Un livre…. dont la critique peut se faire à chaud, à froid, tiède ou……. ! L’épitaphe se suffit à elle-même, dira-t-on, quand l’incidence du mythe apporte une relative inertie au parcours survolé d’une lettre concise et mollement illustrée, mais n’est-ce pas qu’un premier livre ? Point de dureté dans le propos seulement une soif encore là, que la relecture ne parvient à épancher ! « L’amour une source qui a soif », l’amour d’une mère, défunte, s’arrange-t-il du désaveu apatride de la raison, « étranger » au monde qui l’entoure et peut-être même à lui-même ? Ce Meusault si impersonnel et cependant lié ; la froideur avec laquelle il entrevoit la disparition contraste et nous laisse perplexe, l’ambiguïté est le terreau fertile d’où germe le syncrétisme d’une existence morne et sans lendemain, le jour où l’avenir s’éteint, où tout bascule, où affaire de mœurs et crime raciste n’ont jamais été si proches, mais ce Meursault est-il seulement capable de prendre part ?
Camus cultive ainsi le paradoxe et dénonce, par une fenêtre clandestine, la tension devant le conflit, l’attitude apeurée, jamais sereine, caractéristique des masses envahissantes et colonialistes, pusillanime car éloignée des terrassements apaisants de l’identité
Une parabole aseptisée de l’absurde, baignée par la moiteur ocre du soleil d’Alger !
"La peste" - Albert Camus -
- La peste -
La chronique littéraire déjoue assez curieusement les standards d’écritures ; c’est précisément d’une réalité d’arrière-plan, que vient exhumer l’écriture, que rendront timbre et sonorité d’ensemble ; de sorte que la nature des événements relatés, l’établissement des faits selon l’ordre des temps, impliquent que le ton littéraire soit prédéterminé, que l’écrivain devienne « seulement » le chroniqueur obligé d’une condition que l’artifice n’autorise plus.
Camus retrace avec justesse l’épisode de peste bubonique survenu à Oran en 1945, tout en suggérant le dessein probable de l’existence humaine face à la calamité du monde, cet ordre « vacuitaire » d’où se réfracte l’héritage historique des conjonctions et conduites humaines. « Vous savez quels fléaux ont éclaté sur nous ….» dit Voltaire Œdipe II, le fléau est la désolation qui frappe la condition humaine sans prévenir, il est cruel, injuste, et saura se faire oublier. Ce terrassement du néant cause chez l’homme cette forme d’effet retord, semblable à la catharsis dramatique bien qu’éloigné, extirpé de son formalisme rituel, ses actes échappent à la syntonie réflexe, ordinairement établie, il est comme nous l’indique Aristote « purifié par le spectacle du châtiment…. », mais le fléau n’annonce aucune fin, il est présent, force à l’exil, ici l’effet se prolonge par la claustration et l’incertitude du lendemain. Les gens ont cessé de croire, la souffrance est là, le plaisir s’est tu, l’espérance a revêtu le maque blême de la fin attendue.
Un huis clos funeste que le catastrophisme ambiant ne semble atteindre, un trio, mené tambour battant par le docteur Rieu, personnage central du roman, ses deux acolytes que sont Rampert et Tarrou pour qui combat, résolution testamentaire ou intention la plus spontanée fédèrent l’action ; puis le désavoué Cottard, dont l’anarchie libère l’incorrection du malfaiteur abstinent à qui pourtant le narrateur trouve des circonstances atténuantes. Cette confusion qui voit lors de mouvement de masse une sorte de surenchère à la scélératesse matérielle, confusion à laquelle aucun mot ne sied et qui pourtant rend le monde, de ces individus, tolérable.
La qualité indéniable de l’œuvre réside de part l’intensité subjective d’une empreinte sensible sans cesse réinterrogée, lorsque l’innocence se voit transpercée par l’éperon contendant d’une cruauté sans nom, d’un châtiment aveugle et désespérant, pour qui même la foi du père Paneloux ne semble faire de distinction par ailleurs.
L’action des trois hommes recentre le désespoir d’une humanité livrée à elle-même et laisse poindre l‘exhalaison si spéciale d’un optimisme jamais feint, que le contrepoint du sort ne parvient à souffler.
Ainsi le fléau purifie l’humanité de son inconduite, la purgation survient à la manière de la tragédie en corrigeant en nous les passions par la terreur et la compassion - ci-gît le génie Grec, de n’avoir point concédé au hasard le terrible, et l’absurde abîme de l’oubli -, mais aucune leçon n’est autant déshonorante pour l’homme, chacun doit obvier, prévenir le mal, se garder du fléau, ou tout au moins s’y confondre ; telle est la superbe parabole philosophique esquissée par un Camus modéré par la circonstance, en cette période troublée par le cataclysme que chacun entrevoit.
« La peste » repousse avec brio le canevas maquetté de la tétralogie de l’absurde à quoi on attribue confusément l’héritage camuséen.
"Le mythe de Sisyphe" - Albert Camus -
- Le mythe de Sisyphe -
Commode d’affirmer que l’inquiétude philosophique relève de l’absurde, et inversement que la spécialisation ou stratification philosophique ne concerne qu’une part infinitésimale de l’aperception globale, cet argument est tout autant recevable pour la science, dont la volonté des épistémologues les plus obligés approche fatalement l’épistémè d’une métaphysique immuable.
S’il nous est impossible d’atteindre ce degré de subjectivité consubstantiel au questionnement philosophique, il nous reste alors le suicide : « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentales de la philosophie ». Camus introduit son essai par une sentence assez peu enthousiaste, au risque de limiter son développement à la rudesse du sujet ; l’intention d’appliquer, de prime abord, cette topographie du syllogisme « angoissant » trouve une explication pertinente pour l’écrivain resserré, troublé, impatient face à la vie.
L’Absurde peut sans peine être confondu au postulat socratique, cette volonté de retrouver « l’accord perdu du logos et des choses », au minimum d’une certaine franchise intellectuelle face au raisonnement de nature à fonder toute conclusion, ce serait là une explication rationnellement acceptable du point de vue philosophique. Mais Camus pressent la chute de l’inexplicable comme la condition intangible de l’existence, l’absurde fait marche commune avec l’irrationnel et la conscience, si bien qu’il semble irréfutable de concevoir l’absurde avant l’être réfléchi ou rationnel, c’est l’ipséité de la conscience, sa présentification au monde de l’absurde qui prime, le plan réfléchi ou intentionnel (cher à Husserl) semble être un élixir flou d’infortune philosophique, et qu’enfin toute conclusion ne permet d’échapper au suicide, au sacerdoce perpétuel d’un Sisyphe contraint, à la force des bras, de faire rouler son rocher au sommet de la montagne éternelle du Tartare. Un homme à tel point astucieux, contraint par les dieux à vivre des lendemains désolants. Rappelons seulement que Sisyphe déjouât Thanatos et provoquât ainsi la colère inextinguible de Zeus.
Serait-ce un cri d’espoir voire de désespoir que ce « Mythe de Sisyphe », mais pour quelle logique ce contrepoint incisif du suicide, est-ce une fin en soi, que Camus préméditât, une sorte de refoulement littéraire, auquel son destin ne put échapper ?
« Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontre » nous indique Sartre : de fait toute intervention arbitraire porterait atteinte au concept naturel d’existence, à la liberté ; le suicide est un revers à la liberté promue par Sartre et ne trouve pas sa place dans le courant existentialiste. Il est, pour reprendre la terminologie camuséenne, du domaine de l’absurde de mettre un terme à sa vie car l’acte précisément lui ôte toute signification selon Sartre. Il n’est pas nécessaire de s’arrêter à telle considération pour garantir l’inimitié idéologique entre les deux hommes, d’autant que l’un comme l’autre en arrive à la même conclusion, on peut seulement soupçonner un pessimisme latent chez Camus le contraignant à la « révolte ». Sartre fut très peiné par la disparition précoce de Camus, avec qui l’occasion de la réconciliation jamais ne se présentât.
Quand Camus écrit : « Je tire ainsi de l’absurde trois conséquences qui sont ma révolte, ma liberté et ma passion. Par le seul jeu de la conscience, je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort – je refuse le suicide ». Si liberté et passion semblent, selon lui, indissociables et qu’en premier lieu la révolte maintient la conscience d’être en équilibre de tout désir morbide, on constatera qu’il s’agit d’une définition de l’homme névrosé – quel artiste ne l’est pas –, toute dissension psychologique fait rayonner la « philosophie » d’un clair-obscur flottant – impression analogue ressentie à la « nausée » sartrienne, bien que Sartre écrivît à la troisième personne. Sans pour autant concéder à l’idéalisme d’une liberté existentialiste, on peut s’interroger sur la nécessité d’une solution contrapuntique « finale » lancée dès les premières lignes en résonnance du débat philosophique.
Pour autant, la prose virtuose et révoltée de Camus est d’une lucidité sans pareille, sa vision d’une humanité, certes nivelée, est une lucarne clairvoyante sur un panorama auquel chacun peut souscrire, avec un pessimisme plus ou moins saillant d’ailleurs ; c’est seulement que l’argumentation camuséenne aurait une coïncidence beaucoup moins flatteuse à l’estime d’une époque où l’absurde est systématiquement consenti, traduit dans une maïeutique populaire, à l’enchère médiatique constante, que l’éthique tout comme la morale ont grand mal à défendre.
Camus avait certainement raison de s’affirmer comme non philosophe, cette dernière implique une relative pondération, voilà peut-être le péché des âmes révoltées, à qui le destin signifiât le sens de la vie en s’écrasant sur un platane, c’est peut-être finalement la meilleure conclusion d’un ouvrage traitant de l’absurdité de l’existence.
« Je passe mon temps à conseiller le suicide par écrit et à le déconseiller par la parole. C'est que dans le premier cas il s'agit d'une issue philosophique ; dans le second, d'un être, d'une voix, d'une plainte... » Cioran.